Moritz Thomsen
Mes deux guerres
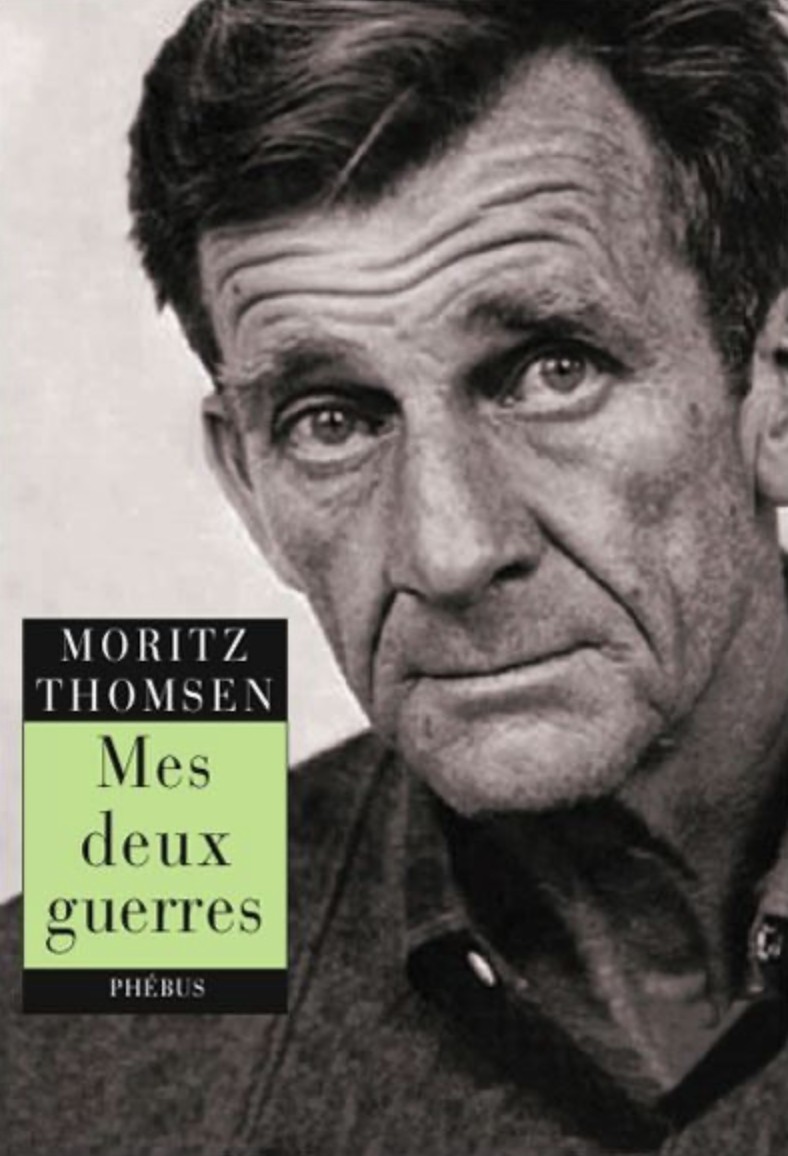
Guayaquil (Équateur), le 28 août 1991 vers huit heures du soir, l’écrivain américain Moritz Thomsen meurt d’une insuffisance pulmonaire. La nouvelle de sa mort mettra alors plus de trois mois à arriver aux oreilles des journaux littéraires américains comme le San Francisco Chronicle. Paul Theroux écrira : « Thomsen est l’un de ces américains doués, inventifs, courageux – l’espèce est rare – dotés d’un solide estomac et d’un sens de l’humour bien noir, qui, quand ils partent, ne sont pas du genre à revenir. Ils ont pris la route et ne la lâchent plus ».
Malgré ces excellentes critiques, Thomsen reste peu connu et peut-être est-il temps de rendre justice à cet écrivain qui a si bien dépeint sa vie aigre-douce dans quatre récits fabuleux. Né en 1915 à Seattle dans une riche famille d’industriels, Moritz Thomsen passe son enfance dans une cage dorée. Seule ombre au tableau : un père violent et névrosé qui rend l’adolescent effacé et introverti. Ces deux anecdotes relatées par Thomsen dans son dernier livre donnent le ton : son père fusillant son chien dans un accès de fureur à cause d’un poulailler saccagé ou bien encore cette nuit où, par plaisir, il accrochera à un fil à linge deux chats par leur queue – provoquant un combat à mort des deux félins. Il sera pour Thomsen la figure d’un paternel castrateur qui le poursuivra toute sa vie. C’est pour fuir cette figure écrasante que le jeune homme s’engage dans l’armée de l’air au moment de la seconde guerre mondiale. Une expérience qu’il vit tant bien que mal dans les bombardiers de l’armée américaine et qu’il racontera dans le dernier livre, qu’il écrit au seuil de la mort dans son petit appartement de Guayaquil, Mes deux guerres (Phébus, 2004).
De retour aux États-Unis, Thomsen, plus attiré par l’agriculture – le métier qu’il revendiquera toute sa vie – que par les affaires familiales, s’embourbe dans un élevage de porcs en Californie. Mis en faillite au début des années 60 par une récession économique, il décide de s’engager à près de cinquante ans dans les Peace Corps, au grand dam de son père qui le traite de « pédé de communiste ». C’est ainsi qu’il débarque à Rioverde en 1965, à quelques encablures d’Esmeraldas. Même si ce qu’il y trouve l’accable (tristesse des lieux, pauvreté, violence) il tombe amoureux de cette région et de ses habitant·es. Il tirera de cette expérience de volontaire un livre, Living poor (University of Washington Press, 1969) considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs témoignages sur cette organisation créée par John Kennedy. C’est aussi et surtout durant cette période de trois ans qu’il se lie d’amitié avec le jeune Zambo Ramon, à qui il propose de devenir son associé à part égale dans une exploitation agricole. Les deux amis s’installent dans une ferme, à Viche, aux abords luxuriants du fleuve Balao.
C’est là qu’on peut voir cet étrange gringo esthète, écoutant du Strauss sur son tracteur et écrivant aux « heures d’avant l’aube, lorsque la terre est encore plongée dans l’obscurité », tomber sous le charme de cette vie simple. Cette vie qu’il a recherché comme un purgatoire, un mode de rébellion aussi face à sa condition de riche occidental. Malheureusement, cette expérience qui durera près de quinze ans se conclut par un échec, tant du point de vue agricole que des relations avec ses voisin·es. Il publie alors son second ouvrage La ferme sur le Rio Esmeraldas (Phébus. 2002, catalogue), sorte de réflexion sur cet échec où il essaye de comprendre les habitant·es peuplant ces jungles malfamées et paludéennes.
Il poursuivra dans une veine beaucoup plus ambitieuse avec Le plaisir le plus triste (Phébus, 2003, catalogue), son probable chef-d’œuvre. Écrit comme un journal de voyage lors d’un périple au Brésil, il s’y décrit d’entrée de jeu comme « un pur gringo, mais plus proche du clochard que du travailleur ». On l’y suit dans une remontée cathartique de l’Amazonie passant en revue toute sa vie, en profitant pour régler ses comptes avec tout ce qui s’est mis en travers de son idéalisme.
Une brouille avec son ami Ramon finit par mettre un terme à l’aventure de Vince. Plus Sisyphe que conquérant véritable du labour, d’une santé de plus en plus vacillante, il finit par baisser les bras et part s’installer dans la capitale équatorienne Quito. Il y passera quelques années avant de repartir vers le climat plus propice de Guayaquil combattre ses problèmes pulmonaires. De plus en plus malade, il passe ses journées à lire, écouter de la musique classique, s’accordant juste de courtes promenades poussives sous les arcanes décaties du centre-ville. Aux visiteur·euses, il lançait de sa chambre du deuxième étage les clefs de son appartement afin qu’ils et elles puissent ouvrir et monter. Il meurt à 75 ans, à bout de souffle. La poisse le poursuivra jusqu’au bout et même dans l’au-delà : l’incinérateur de Los Jardines de la Esperanza tombe en panne, le corps attendra une nuit… Ses cendres sont finalement jetées dans la rivière Balao qui aura vu une partie de sa vie s’écouler.
Related
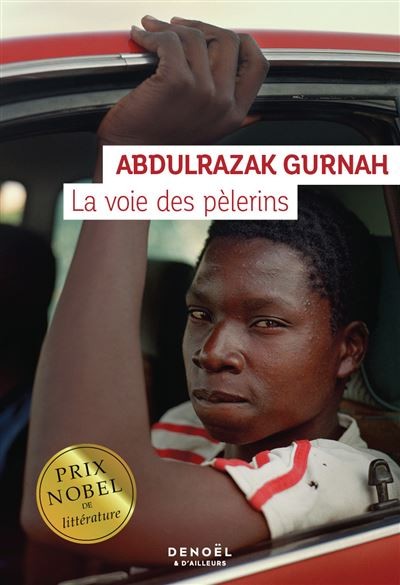
La voie des pèlerins

Nager sa vie
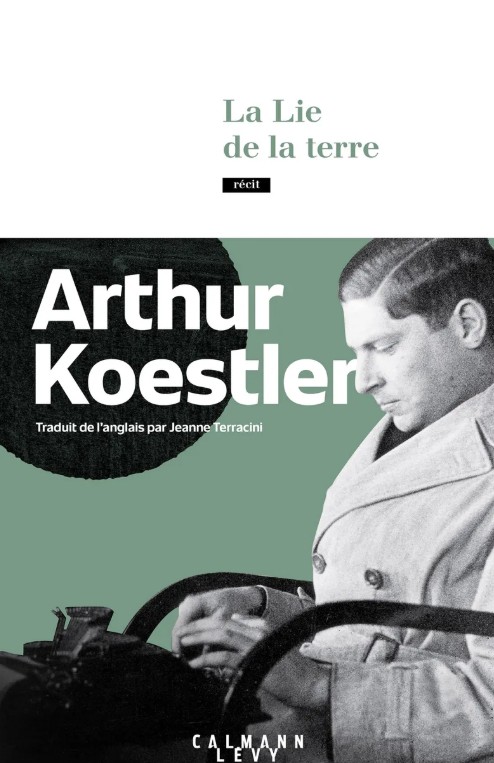
La lie de la terre
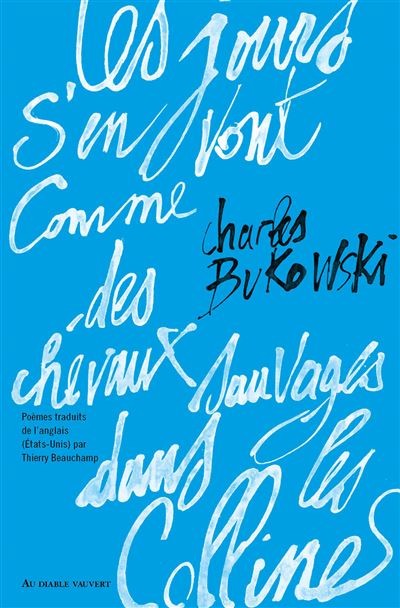
Les jours s’en vont comme des chevaux sauvages dans les collines
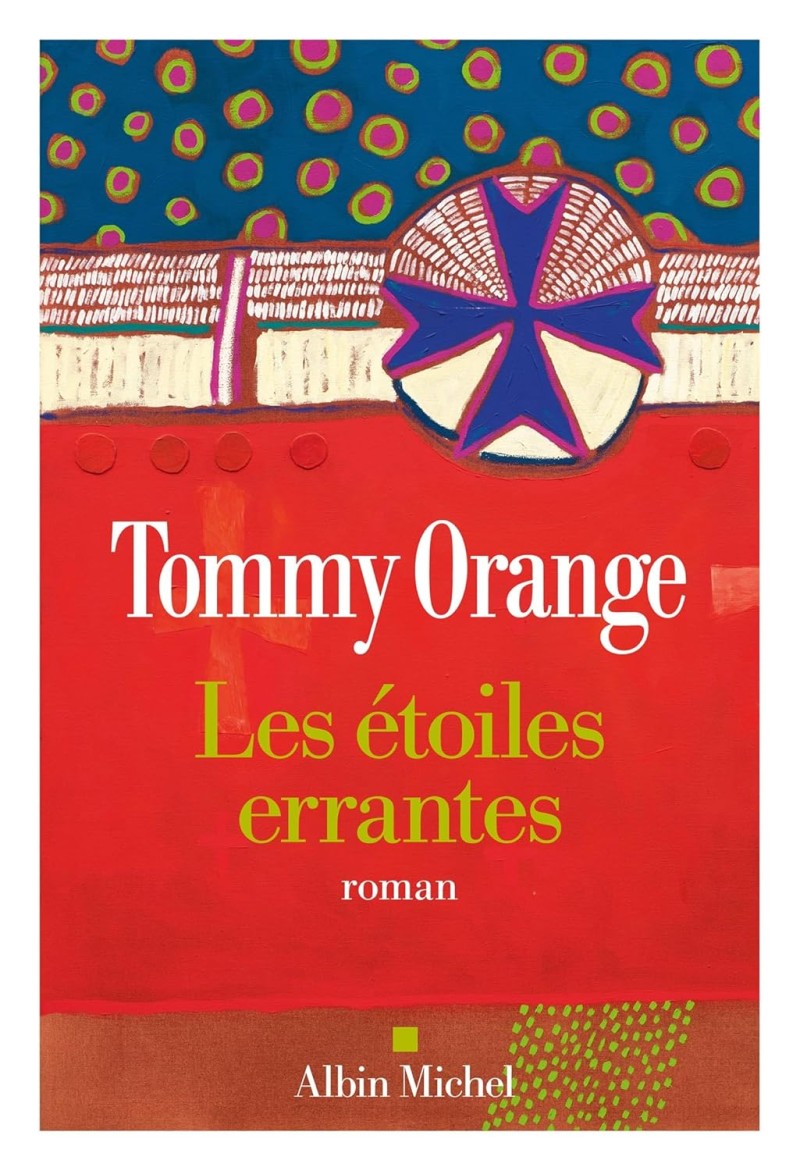
Les étoiles errantes

Pathemata ou L’histoire de ma bouche
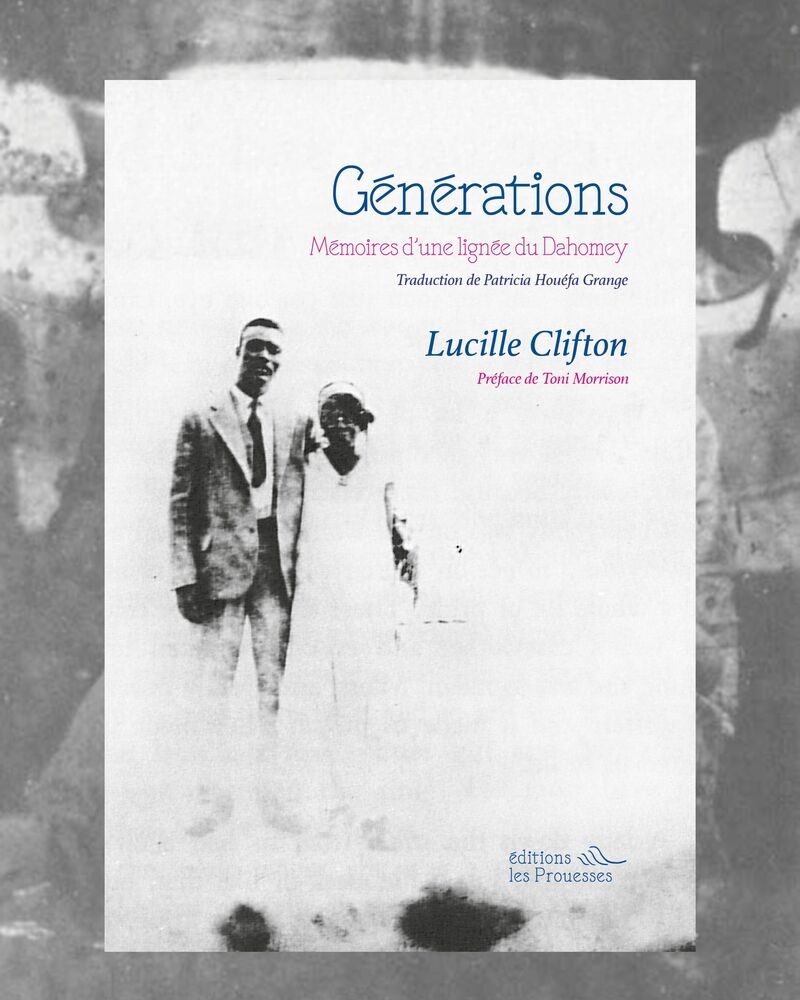
Générations : mémoires d’une lignée du Dahomey
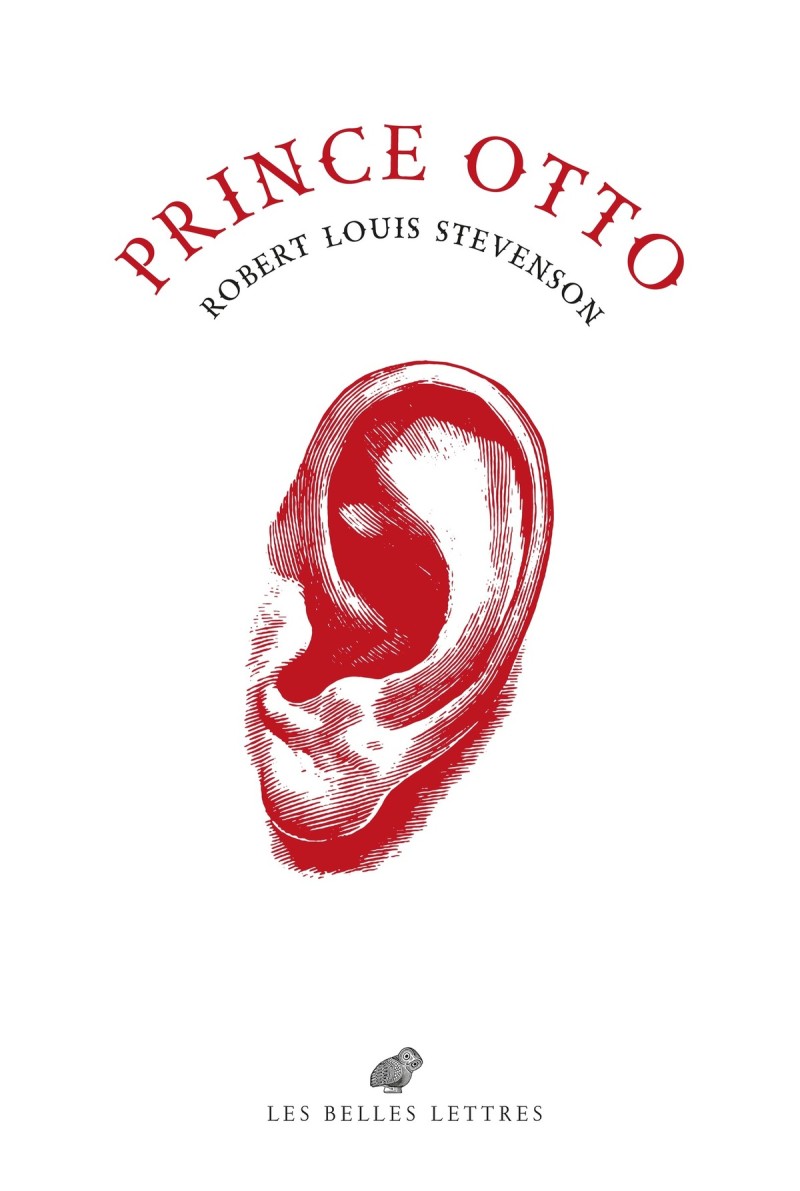
Prince Otto
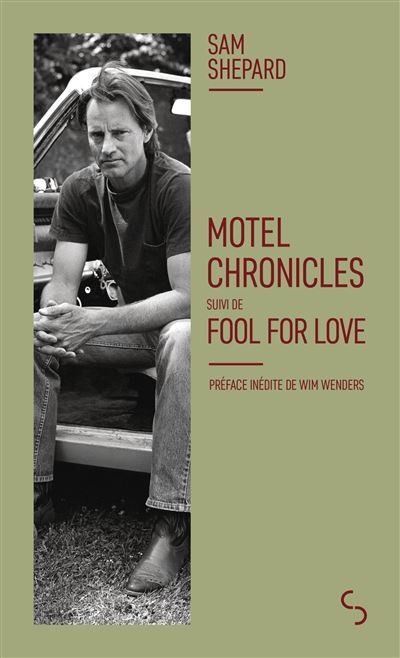
Motel chronicles

Les terres indomptées

Ootlin
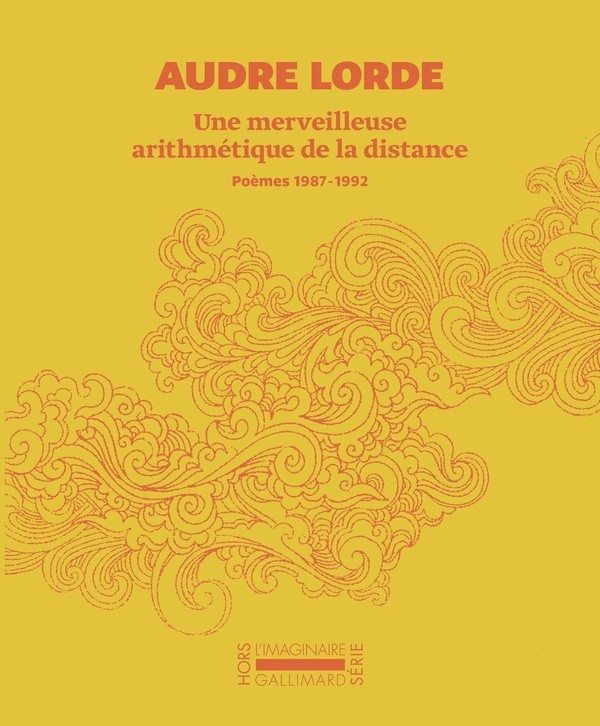
Une merveilleuse arithmétique de la distance